TOUT SAVOIR SUR LA CHEVÊCHE D'ATHENA |
|
La Chouette Chevêche est une espèce relativement petite puisqu’elle mesure 25 cm pour une envergure de 60 cm. Le poids varie de 140 à 180 gr pour le mâle contre 150 à 200 gr pour la femelle (Génot, 1994).
La femelle pond en moyenne 4 ou 5 œufs avec des cycles de reproduction se calant sur les cycles de ses proies, essentiellement les campagnols. Cette "petite chouette", un peu plus grosse qu'un merle, originaire du bassin méditerranéen, est reconnaissable à ses disques faciaux blanchâtres marqués de brun. Ceux-ci servent à amortir les ondes sonores et à les amplifier, ce qui lui permet de repérer plus facilement ses proies. Sa tête est roussâtre, tachetée de blanc, large et plate. Sa poitrine et ses flancs sont blancs jaunâtres, fortement rayés et barrés de brun. Une mue est observable de juin à septembre. Le plumage, quant à lui, est identique pour le mâle et la femelle. Ses pattes sont emplumées jusqu'aux serres. Elle est identifiable à son vol ondulé, de cavité en cavité ou de perchoir en perchoir ainsi qu’à ses battements d'ailes rapides.
Elle est capable de faire un vol stationnaire, comme certains autres rapaces tel le Faucon crécerelle, ce qui lui facilite le repérage de proies. Son espérance de vie est relativement faible puisque la longévité maximale est de l’ordre de 8 ans.
|
Au niveau national, on rencontre 2 sous-espèces : noctua et vivaldii.
La Chevêche d'Athéna, comme toutes les espèces européennes de rapaces, est protégée en France par l'article 1 de l'arrêté du 17/04/81 modifié par arrêté du 2/11/92, ce qui implique "l'interdiction de destruction ou d'enlèvement des oeufs et des nids, la destruction, la mutilation, la capture ou l'enlèvement, la naturalisation des oiseaux visés, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente ou leur achat".
Elle est également soumise à deux conventions internationales : la Convention de Berne du 19 septembre 1979, qui protège les milieux naturels et la vie sauvage, et la Convention de Washington (Cites) du 3 mars 1973, qui protège et réglemente le commerce des espèces de faune et de flore sauvages qui sont menacées d'extinction (elle entre dans l'annexe II).
Chasse et régime alimentaire : la capture des proies a essentiellement lieu au sol. La Chevêche, perchée sur un poteau, une branche, un point de vue particulièrement dégagé, les repère et se jette sur elles pour les saisir. Au quotidien, elle a besoin de 50 à 80 grammes de nourriture (insectes, petits mammifères, petits oiseaux…). Elle avale ses proies entières et l’estomac rejette les os, les poils, les plumes…sous forme de pelotes de réjection. Les oiseaux (ex : moineaux, mésanges…) sont surtout consommés au cours de l’hiver, d’autant plus si ce dernier est rigoureux. Le Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) et le Campagnol des champs (Microtus arvalis) sont ses deux proies favorites. À noter que lors de l’élevage des jeunes, elle va capturer d’avantage d’insectes, qui, du fait de leur abondance, sont attrapés rapidement mais surtout parce qu’ils sont aussi plus riches en graisses et en glucides (Juillard, 1984).
Habitats : ce petit rapace nocturne est aussi appelé Chouette des pierres, des terriers, des pommiers, des murs, des tuiles... ce qui caractérise bien l'espèce. En effet, elle nidifie dans des cavités d'arbres vieillissants, des tas de pierres et des corps de ferme. Elle est inféodée aux terrains ouverts ou aux terrains semi-boisés avec des parcelles où l'herbe est rase et des perchoirs faciles d'accès pour la chasse. C'est pourquoi on la retrouve dans les secteurs pâturés, les alignements d'arbres, les vergers, les haies, les parcs, les lisières de bois... On sait aussi que, dans les secteurs où les cavités naturelles font défaut, elle apprécie les bâtiments agricoles. Par contre, elle évite les forêts, car la végétation y est trop dense. On considère qu'un endroit lui est favorable à partir du moment où il présente des potentialités d'utilisation, au cours de l'année pour l'alimentation et pour la nidification.
La nidification a lieu dans des cavités naturelles, plus ou moins profondes, d'une faible hauteur, en général inférieure à 6 m, les amas de pierres, les vieux vergers, à partir du moment où ces endroits sont assez obscurs et que leur entrée est de faible diamètre (environ 7 cm). La nidification dans les arbres représente 42 % des nichées en France (Génot, 1992) et les vergers vieillissants constituent pour l'espèce un moyen naturel pour trouver les cavités nécessaires à sa reproduction. Ils offrent un habitat idéal, puisque la Chevêche y aura son nid, ainsi que son territoire de chasse, la strate herbacée y étant souvent fauchée. Cependant, faute de cavités naturelles, elle a su s’adapter aux nichoirs de différents modèles installés spécialement pour elle, à l’abri des intempéries et le plus souvent des prédateurs grâce à la mise en place d’un système anti-prédation.
La Chevêche est sédentaire et très attachée à son territoire. Ce dernier n’excède pas 1 km² avec, en son centre, le site de nidification.
Répartition : au niveau mondial on remarque que cette espèce ne s'aventure pas au-dessus d'une ligne imaginaire qui s'étend de l'Écosse (où elle a été introduite) au sud de la Russie. Au Sud, on ne la retrouvera pas au-dessous d'une ligne qui relie l'Afrique du nord-est au Sud de la Russie. Elle a profité du défrichement des forêts de l'époque historique pour étendre sa répartition à l'ensemble de notre pays.
En France, le Bassin Parisien est la limite Nord de son aire de répartition et elle n’est pas présente au-dessus de 500 m d’altitude. On estime que la France accueille au total 10% de la population nicheuse européenne, soit entre 11 000 et 33 000 couples. |
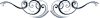
TOUT SAVOIR SUR L'EFFRAIE DES CLOCHERS |

|
On l'appelle aussi Chouette effraie. Elle est l'un des cinq rapaces nocturnes de l'Essonne mais la seule représentante des Tytonidés.
De taille moyenne (35 cm pour 350 grammes et 1 m d'envergure), elle est aisémentreconnaissable grâce à sa couleur claire et ses deux disques faciaux blancs qui lui ont valu le nom de "Dame blanche".
Son chuintement, long cri tremblé, et le ronflement qu'elle émet sont aussi très particuliers et ont sans doute contribué à susciter les persécutions dont elle a été l'objet par le passé.
Elle s'est très bien adaptée à la présence humaine et affectionne pour nicher les clochers, les hangars agricoles et les greniers accessibles qui lui procurent la cavité en situation élevée qu'elle recherche.
Elle y accumule dans un recoin obscur une litière faite de pelotes de réjection.
Elle chasse la nuit, principalement en vol, en repérant ses proies au son (essentiellement des micromammifères et quelques oiseaux et chauve-souris), elle-même étant particulièrement silencieuse grâce à la garniture en duvet du bord de ses ailes. |
Sa période de reproduction peut couvrir une grande partie de l'année, une première ponte se produisant au printemps avec un maximum en mars et une deuxième ponte pouvant se dérouler en fin d'été si les conditions de nourriture sont favorables. Mais des pontes ont été observées en janvier et des envols de jeunes quasiment à Noël ! Les œufs, 6 en moyenne, de la taille d'œufs de pigeon, blancs et mats, éclosent après 31 jours. Les jeunes quittent le nid vers 8 à 10 semaines. On estime malheureusement que 60% des jeunes meurent avant un an. Leur dispersion s'étend en moyenne sur 80 km mais un record de 1200 km a été enregistré.
Pour chasser, l'Effraie a besoin de milieux ouverts. Elle est donc absente des zones boisées et des agglomérations trop denses du nord du département. Par contre elle était très fréquente dans les villages et les fermes. Elle est hélas soumise à des contraintes et agressions diverses qui contribuent à son déclin : raticides, collisions avec des voitures lorsqu’elle chasse à ras du sol, fermeture des clochers pour interdire l'accès aux pigeons, réhabilitation de bâtiments qui éliminent des sites accueillants. |
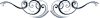
|
|

 Qui sommes-nous ?
Qui sommes-nous ? Agir pour la nature
Agir pour la nature Découvrir l'Essonne
Découvrir l'Essonne Etudes et gestion
Etudes et gestion Suivis
Suivis Photothèque
Photothèque

